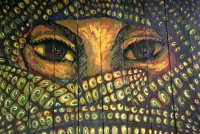IV. Quelques questions sur l’autonomie
La manière qu’ont les zapatistes de conduire leur lutte amène à poser une série de questions et à tenter d’y apporter un début de réponse. Pour finir, nous envisagerons quatre questions liées à la construction de l’autonomie.
En premier lieu, on peut se demander quels chemins va emprunter le développement de cette autonomie, confrontée actuellement à de nouveaux défis. Dès l’instant où a été formée, de pair avec d’autres instances régulant la vie sociale, une instance de gouvernement régional, les communautés zapatistes en résistance sont entrées dans une dynamique complexe.
D’une part, un progrès radical a eu lieu, l’autogouvernement érodant continuellement les relations de domination qui pèsent sur les communautés depuis des temps immémoriaux. Le caciquisme et le rôle néfaste joué par les partis politiques aussi bien que la dépendance économique et la marginalisation sociale reculent devant l’essor de l’auto-organisation. L’autodétermination et le contrôle d’éléments au centre de la vie sociale tels que la terre et, par conséquent, l’alimentation, la santé, l’éducation et la culture élargissent et renforcent de même les capacités de la résistance zapatiste.
D’autre part, une certaine institutionnalisation est en cours, qui pourrait faire échouer, dans certaines circonstances, cette tentative d’autonomie et stopper net le processus d’émancipation. Un rôle décisif est joué en ce sens par la politique de contre-insurrection menée par le gouvernement fédéral et par le gouvernement chiapanèque, à laquelle s’ajoutent évidemment le contrôle et la pression qu’exercent les grandes puissances mondiales au détriment des communautés en résistance. Les pressions de toutes sortes maintenues quotidiennement par une guerre déclarée et livrée sur tous les fronts sont parfaitement capables de faire surgir des tendances autoritaires au sein des pouvoirs autonomes, qui commenceraient ainsi à se séparer de la vigilance des communautés et à imposer leur autorité.
Cette menace issue d’un affrontement avec le pouvoir n’est cependant pas la seule. L’échelonnement des divers niveaux d’administration autonome pourrait conduire à d’éventuelles séparations entre les conseils de bon gouvernement et les assemblées des communautés.
En appliquant un raisonnement zapatiste, on pourrait dire que les conseils prouveront qu’ils pratiquent un « bon gouvernement » dans les faits, à partir du moment où les hommes et les femmes qui participent à cette tentative d’autonomie (représentants et communautés) seront en mesure d’appliquer et de mettre en place les méthodes qui ont rendu possible leur résistance jusqu’ici. De même, c’est l’expérience qui montrera si la tutelle qu’exerce l’EZLN sur les conseils de bon gouvernement tend à disparaître ou au contraire à s’accentuer, renforçant ou pervertissant ces instances autonomes.
Tout aussi important, et risqué, est le statut d’« organe de gouvernement » qu’incarnent les conseils devant les communautés non zapatistes avec lesquelles le territoire est partagé. Désormais, un conflit quotidien aura lieu, car il ne fait aucun doute que les pouvoirs locaux et le gouvernement mexicain tenteront d’acculer les instances autonomes à « réprimer » les membres de ces communautés non zapatistes. Cela mettra à dure épreuve les méthodes consensuelles et la capacité de résistance et de mobilisations des zapatistes. Une reconnaissance dans les faits des conseils de bon gouvernement par ces communautés non zapatistes sera déterminante, attendu que la Constitution mexicaine ne reconnaît pas les droits des peuples indigènes, et en particulier le droit à leur autonomie [1].
Enfin, la lutte pour la reconnaissance des droits des peuples originels du Mexique ne s’arrête pas à la naissance des conseils de bon gouvernement. Devant la courte vue des pouvoirs fédéraux, il continue d’être nécessaire d’exiger la reconnaissance du droit de tous les peuples à l’autodétermination et à se gouverner comme ils l’entendent. Si la voie qu’emprunte principalement le mouvement zapatiste est la construction de l’autonomie dans les faits, il n’en reste pas moins que leur reconnaissance par la Constitution est une mesure indispensable pour tout régime véritablement démocratique et, partant, il s’agit d’une exigence à l’échelle nationale qui interpelle l’ensemble de la société mexicaine.
Le renforcement du développement de l’autonomie au Chiapas pose un autre problème. En quoi la contribution de l’expérience zapatiste peut-elle aider à la transformation sociale dans d’autres conditions, en particulier dans les grandes villes [2] ? Les difficultés d’une transformation des relations sociales sont énormes dans les sociétés hautement stratifiées où la division du travail, la spécialisation, la séparation et l’individualisation ont cours depuis des siècles et ont fortement marqué de leur empreinte individus et collectivités.
La première difficulté que nous pouvons évoquer sur ce terrain est celle qui consiste à reconnaître les problèmes auxquels s’affronte la construction d’espaces autonomes dans les grandes villes. En s’appuyant sur l’expérience zapatiste, on peut dire que ces problèmes sont essentiellement de deux ordres : le type de communautés qui existent dans les villes et, ce qui en découle, l’apparente « incapacité » de ressaisir les bases immédiates de la reproduction sociale.
Résultat caractéristique du capitalisme, la plupart des regroupements dans les villes se constituent au regard d’une extériorité : loin d’être le lieu de la libre détermination de leurs participants, ces pseudo-communautés correspondent aux différents modes d’organisation sociale capitaliste, notamment en ce qui concerne l’organisation de la passivité (consommation, spectacles) et les institutions sociales (corporations, communautés religieuses et éducatives). Toutes ces communautés « factices » [3] ont en commun une structure fortement hiérarchisée où les mécanismes de prise de décision sont aux mains de très peu de personnes (généralement étrangères à la communauté en question, comme dans le cas des spectacles) et où le dialogue authentique fait entièrement défaut.
Nous pensons que la construction de communautés d’habitants des villes adoptera des formes multiples. Certaines ne naîtront qu’en cas de rupture sociale (pensons aux travailleurs de l’industrie), d’autres seront le produit d’un lent mûrissement dans un milieu désorganisé (dans les quartiers, par exemple, qui conservent au Mexique une forte unité culturelle mais dont les expressions sur le terrain de la lutte sociale se comptent sur les doigts de la main), tandis que la recherche d’une alternative au modus vivendi dominant débouchera sur la formation de nouvelles communautés (chose que l’on peut déjà observer chez certains groupes de jeunes).
À noter un trait essentiel dans le cadre d’une telle éventualité : dans les sociétés hautement stratifiées, les communautés posséderont des caractéristiques différentes des communautés qui constituent aujourd’hui le socle des luttes sociales indiennes et paysannes et s’articuleront autour de deux grands secteurs de la vie sociale.
En premier lieu, les solutions apportées à la survie de l’individu et de la collectivité passeront forcément par un raffinement des modes de production de la richesse sociale. L’automation, l’emploi de technologies respectueuses de l’environnement, les changements d’orientation de la consommation, notamment les habitudes alimentaires, sont trois exemples de changements susceptibles de fournir une base à de nouvelles communautés urbaines, naturellement synchrones de celles des campagnes.
En deuxième lieu, la construction de communautés dans de tels milieux exige de briser les mécanismes de la domination capitaliste en matière de prétendu « temps libre » et de dépasser les spécialisations de la sphère « politique ». L’un des apports les plus important du mouvement zapatiste est le retour du dialogue comme élément primordial de la communauté. Là où règne un monopole de la communication (celui des médias) et de la politique (celui de l’État), il est indispensable de trouver les moyens d’une communication transparente et collective. Nous pensons que c’est en partie ce qui se passe actuellement dans les rencontres qui ont lieu aujourd’hui (les rencontres zapatistes, les assemblées de quartier ou les organisations argentines de piqueteros en sont quelques exemples) et dans l’édification de nouveaux modèles de communication horizontale non hiérarchique.
Dans une telle perspective, il faut bien admettre que l’on se heurte aussitôt à un obstacle majeur. La dépossession dans les milieux urbains est en effet très distincte de celle à partir de laquelle ont germé les autorités autonomes zapatistes : un territoire existe, tout réduit ou pauvre qu’il soit, qui satisfait à un minimum de besoins pouvant être autogérés. Les habitants des villes n’ont aucun contrôle sur les moyens de satisfaire leurs besoins immédiats : être salarié ou dans une situation précaire rend quasi indispensable le recours à l’argent. L’occupation d’usines et les circuits de troc en Argentine fournissent un exemple d’une manière de reprendre éventuellement le contrôle de nos moyens d’existence. Cependant, nous pensons qu’avec cela le problème de fond n’est pas réglé, étant donné que ces procédés autogestionnaires se montrent incapables (pour l’instant) de détrôner l’argent et la production de marchandises en tant que mécanismes de distribution et de production de richesse sociale [4].
Cela nous amène à évoquer une autre différence entre la situation des communautés zapatistes et celle des villes. L’accès à la richesse sociale dans les villes est sans doute beaucoup plus élevé, mais, chose plus importante, on sait que cet accès dépend de relations de pouvoir (pouvoir d’achat, mais pas uniquement), de sorte qu’une pratique autonome implique soit une rupture radicale avec de telles relations de pouvoir – ce qui la met dans une position vulnérable par rapport au marché, à l’État et aux capitalistes –, soit un nombre de médiations énorme et très souvent insurmontable – qui finissent presque toujours par étouffer tout effort d’indépendance de leur part et/ou qui les fait dégénérer en entreprises capitalistes « rentables » [5].
Il s’agit là d’une question ouverte au débat et sur laquelle la pensée critique et la lutte sociale devront travailler durement pour être en mesure de proposer une alternative…
En troisième lieu, une comparaison entre le mouvement zapatiste et d’autres révolutions paysannes du passé s’impose, car nous pensons qu’elle peut aider au développement de notre réflexion sur un monde où aient leur place plusieurs mondes. Nous nous contenterons d’évoquer deux points, à notre avis essentiels.
Premièrement, comme nous l’avons dit, l’armée insurrectionnelle d’Ukraine (1918 à 1921) et les milices anarchistes de la guerre civile espagnole (1936-1937) ont en commun avec l’EZLN le projet de se dissoudre, de ne pas se transformer en un nouveau pouvoir qui opprime le peuple et de séparer nettement les impératifs militaires et ceux de l’autogouvernement.
Deuxièmement, nous constatons, chose particulièrement réconfortante, que les zapatistes sont jusqu’ici parvenus à éviter la tentation de se « militariser » qui eut des conséquences désastreuses sur les révolutions paysannes du XXe siècle. Forts d’une vision à très long terme, les zapatistes montrent que l’important n’est pas de « vaincre » l’ennemi mais de construire quelque chose de nouveau, dans lequel au terme de la guerre les relations entre êtres humains auront véritablement changé. Aussi bien en Ukraine, sous la pression néfaste de l’Armée rouge, qu’en Espagne, à cause des désaccords entre organisations anarchistes et de leur rôle central dans le combat contre Franco, les armées paysannes finirent par se convertir en simples guerriers et furent anéanties parce qu’elles s’étaient privées de leur arme essentielle, leur lien avec la population [6].
D’autres questions telles que la planification de l’économie, le rôle des alliances et de l’évolution d’autres luttes sociales mériteraient elles aussi une étude comparative entre ces trois mouvements révolutionnaires.
Les zapatistes montrent que la stratégie d’une lutte ne naît pas de la théorie, d’un programme ou du bilan des expériences historiques – ou pas seulement –, mais se construit dans l’expérience collective de la résistance :
« Notre façon d’agir, c’est de faire d’abord la pratique et, ensuite, la théorie […]. Nous, on a une idée et on la met en pratique. Nous pensons que ce sont de bonnes idées mais, une fois mises en pratique, on voit s’il y a des problèmes, et comment nous allons résoudre ces problèmes. » (Major insurgé d’infanterie Moisés.)
Coyoacán, octobre-novembre 2003.
Raúl Ornelas Bernal
Traduit de l’espagnol (Mexique) par Ángel Caído.
L’Autonomie, axe de la résistance zapatiste
suivi de L’Autre Campagne : hypothèse plébéienne,
éditions Rue des Cascades,
« Les livres de la jungle », Paris, 2007.
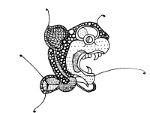
 lavoiedujaguar.net
lavoiedujaguar.net