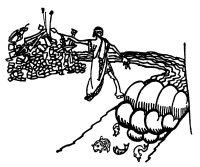II. Il était une fois…
Dans le chapitre précédent, je m’étais surtout attaché au lien qui unissait irrémédiablement la naissance de l’État à celle de la monnaie — plus précisément à une tournure d’esprit dont la monnaie est la confirmation. Je pense que ce rapport entre le pouvoir et l’argent a été trop souvent sous-estimé, quand il n’était pas ignoré, par les historiens et surtout par les philosophes. Je n’ai fait qu’aborder bien trop légèrement cette question qui mériterait un large développement. Mon propos ne consiste pas à m’attacher à la monnaie en tant que moyen d’échange, mais à saisir la dérive de la notion de valeur aboutissant à cet objet de valeur un peu particulier qu’est la monnaie. La formation des États représente un changement important dans l’organisation de la société. Ce changement dans les mœurs s’accompagne d’un changement dans les esprits si bien qu’il est difficile de distinguer les deux : la formation des États et la tournure d’esprit que cela implique. Cet intérêt pour notre façon d’appréhender notre relation à autrui, se modifiant peu à peu en fonction du devenir de la société, fut celui de Louis Gernet dans son article déjà cité dans les notes précédentes. J’invite le lecteur intéressé à se reporter à l’article de Louis Gernet « La notion mythique de la valeur en Grèce » qu’il trouvera dans le livre intitulé Anthropologie de la Grèce antique, paru dans la collection « Champs », Flammarion, en 1995.
La formation des États favorise le commerce entre les peuples. La naissance de l’État apporte avec elle, comme conséquence indirecte [1], celle de l’activité marchande. L’État assemble ce qui était séparé. Il intègre, il assimile dans un mouvement qui lui est propre des sociétés différentes, jalouses de ce qui constituait leur identité, et qui, souvent, s’opposaient entre elles et se heurtaient dans des conflits qui n’avaient pas de fin. C’est bien ce mouvement d’unification, d’assemblage un peu forcé sous le joug d’une autorité supérieure qui définit le mieux ce que l’on entend par État. La domination d’un peuple (guerrier et nomade) sur d’autres peuples (paysans et sédentaires) conduit à une refonte de la société coutumière dans un ensemble plus vaste et plus complexe formé de plusieurs peuples (le peuple conquérant et les peuples conquis et dominés). Cette transformation profonde de la vie sociale apporte de nouvelles conditions de vie et favorise la communication entre les peuples placés sous une autorité unique. Pendant très longtemps ces peuples vont garder leurs usages et leur mode de vie, mais peu à peu ce qui constituait leur identité et leurs caractères propres, sans disparaître complètement, tend à se dissoudre dans un ensemble plus vaste, pour s’amollir, se débiliter et se fondre dans une nouvelle société, tiraillée intérieurement par des forces centrifuges, mais dont les membres se trouvent désormais mis en rapport et en communication, ne serait-ce que par le biais d’une religion commune et de sa mise en scène. J’ajouterai que c’est là un travail considérable et très lent, se poursuivant sur plusieurs générations et que les résistances passives à un changement impliquant une perte d’identité — pour la conquête d’une autre identité, plus questionnable — sont loin d’être négligeables [2].
Jusqu’alors nous pouvions distinguer trois formes d’échange qui, toutes, tournaient autour du don et de son retour. Chaque peuple (ou chaque tribu ou chaque communauté de pensée) se distinguait des autres par un mode d’échange qui lui était propre, reposant sur la coutume et des règles d’usage ou de savoir-vivre. En marge de ce mode d’échange lié à la coutume, les anthropologues ont repéré deux autres modes d’échange, l’un qui n’a pas la dimension sociale des règles coutumières et qui se trouve donc en deçà de l’échange social, c’est l’échange privé entre particuliers appelé troc ; l’autre qui se trouve au-delà du droit coutumier, qui s’en est en quelque sorte dégagé, c’est l’échange cérémoniel ou échange entre clans, entre tribus ou entre « amiks » lointains appartenant à d’autre tribus. J’ajouterai que dans la vie réelle des tribus ces trois formes d’échange sont le plus souvent confondues. La question que je me pose est la suivante : que deviennent-elles avec la formation des États ?
Je dirai qu’au niveau de la vie communale et de voisinage le changement, à première vue, est peu sensible. Il y a bien un changement apporté par le mouvement d’unification des mœurs, qui gomme peu à peu les différences pour les couler dans le même moule. Cependant certaines pratiques comme celles du don et du don en retour sont très difficilement extirpées. La notion du don est encore importante, et même, le plus souvent, prépondérante, et constitue la base d’un « savoir-vivre » communal. Les modifications les plus nettes vont toucher ce que j’appellerai le plan extracommunal et elles vont surtout concerner ce qui se trouvait en deçà (le troc) et ce qui se trouvait au-delà (l’échange cérémoniel et le défi public) de la vie communale. Nous retrouvons dans ce dévoiement de l’échange tout le caractère ambigu de la marchandise, qui se présente comme un « faire-valoir » et participe ainsi du défi public, mais sous une forme dévoyée ; et de l’échange marchand, qui reste un échange privé entre particuliers qui rappelle le troc. C’est à ce niveau qu’intervient le contrat préalable, l’entente entre les partenaires de l’échange et la fixation du retour.
La classe au pouvoir se réserve l’échange de type cérémoniel, mais cet échange est dévoyé en représentations, le défi réduit à n’être qu’un sacrifice, et la notoriété fixée, coagulée, dans une hiérarchie et dans un paraître. Et ce sont les marchands qui vont habiller les nobles selon leur place convenue dans la société. L’élite de la pensée s’étant réservé l’échange cérémoniel proprement dit, il ne restait plus pour l’échange entre les gens, qui constituaient la population de l’empire ou du royaume, que l’échange pauvre, assimilable au troc dont le retour est désormais fixé par le marchand comme le tribut [3] qu’ils devaient à l’empereur ou au roi était, lui, fixé et imposé par l’État. À la fin de l’Ancien Régime cet impôt était même « affermé », et son recouvrement (avec intérêts) était à la charge des grands bourgeois qui l’avaient avancé au roi.
☀
Ce ne sont pas les marchands eux-mêmes qui créent la monnaie, c’est l’État, ou un pouvoir local, qui prend en général l’initiative de créer et de frapper par un sceau, certifiant et garantissant leur valeur, des pièces de monnaie. L’échange marchand est l’expression d’un pouvoir qui s’immisce peu à peu dans une activité jusqu’alors laissée à l’initiative des gens, c’est le pouvoir qui pénètre subrepticement jusque dans la tête des hommes et des femmes, pour les déposséder de leur pensée spéculative — et cette pensée spéculative est dès lors réservée à certaines catégories sociales, aux marchands en premier lieu, mais aussi, dans une moindre mesure, à la classe encore dominante. Le pouvoir ne peut être qu’intéressé par un tel développement et une telle mutation. Le renforcement du pouvoir d’État va de pair avec le renforcement de l’emprise de l’argent sur les individus. Princes et marchands ne pouvaient que s’entendre comme larrons en foire. L’étude de la fin du Moyen Âge en Europe nous en fournirait maints exemples.
Dans l’Occident de nos origines, le maître antique a besoin d’esclaves marchandises comme il a besoin de se distinguer du commun, de se montrer comme appartenant à la classe de la pensée. Le marchand lui fournit les deux, les esclaves et les parures. La fonction réservée au maître serait plutôt celle de la production grâce au travail de ses esclaves ou de ses sujets, en Grèce nous pourrions évoquer la production de blé ou de minéraux grâce aux mines d’argent et de plomb du Laurion, ou, dans une moindre mesure, de fer, du cuivre aussi (Chypre) et dans lesquelles travaillent des esclaves, etc., productions diverses que lui achète le marchand. Ainsi le maître se trouve-t-il embringué dans un processus marchand qu’il ne contrôle pas toujours [4] (ou qu’il est loin de contrôler), mais où il trouve intérêt, si bien qu’il soutiendra l’idée que le marchand se fait de l’échange, sans être lui-même un marchand.
Je ne sais pas vraiment comment l’échange de denrées se faisait au niveau de la population ; sans doute les formes traditionnelles ont dû se perpétuer sans trop de changements significatifs pendant encore très longtemps sous la forme bien connue du troc au cours duquel chaque partenaire estime selon des critères qui lui sont propres la part à donner ou qui lui revient. Il a pu y avoir l’utilisation d’un article de référence comme la fève de cacao ou des couvertures pour des échanges plus anonymes quand les partenaires ne se connaissaient pas. L’échange marchand et les marchands font leur apparition sur une tout autre échelle de l’échange : un échange qui déborde largement celui qui a cours à l’intérieur d’une communauté et qui se rattache à la fois au troc et à l’échange cérémoniel. Je pense que la monnaie ne fut utilisée que d’une manière exceptionnelle pour des échanges qui dépassaient largement par leur ampleur le quotidien des gens et dans lesquels apparaissent des intermédiaires étrangers à la vie sociale proprement dite, que ce soit celle de l’aristocratie, que ce soit celle des peuples sous domination. Les premiers marchands se présentent comme des intermédiaires dans des échanges lointains entre des partenaires qui ne se connaissent pas nécessairement. Être marchand devient une profession, mais une profession à part, qui se trouve dans un « entre-deux », en marge de la vie sociale proprement dite. À ce sujet j’évoquerai volontiers les marchands aventuriers, prédateurs sans scrupules s’aventurant aux confins des mondes connus, tels qu’ils réapparaissent à la Renaissance [5], à la fois marchands et un peu « pirates » (dans le sens que les historiens donnent à ce mot).
Dans leur livre consacré à l’histoire de la Grèce [6], Claude Mossé et Annie Schnapp-Gourbeillon posent une question particulièrement intéressante : les marchands forment-ils une catégorie professionnelle indépendante ou ne sont-ils que les représentants du roi mycénien ? — « Personne n’est en mesure de dire actuellement s’il existait des marchands politiquement indépendants ou si ne s’expatriaient que les représentants des rois mycéniens » (p. 75).
Les marchands ne sont pas non plus obligatoirement recrutés dans les dépendances mycéniennes, ils peuvent venir d’ailleurs, on voit bien qu’ils se posent comme intermédiaires dans des échanges qui débordent largement les échanges régionaux ou locaux, pour pénétrer un marché entre États ou qui concerne les États : importation ou exportation de matières premières, de denrées alimentaires ou d’articles fabriqués pour être ensuite redistribués et diffusés à l’intérieur de la société, soit par l’intermédiaire de l’État et de ses représentants, soit par les marchands eux-mêmes. Un peu comme si l’État tel que nous le concevons était amené à se décharger d’une de ses prérogatives, jugée secondaire, sur une catégorie professionnelle indépendante. À la naissance des États, le commerce était, sans doute plus fermement qu’on ne le pense couramment, emboîté et imbriqué dans le politique — et il l’est toujours, nous expliquons ce fait par la prise du pouvoir par la bourgeoisie et nous le voyons comme une exception, et si cet état d’exception était la règle ? Cet aspect important de la vie commerciale liée à la vie politique est mal connu et peu étudié. C’est sans doute au sein même de la vie politique où prédomine l’échange cérémoniel ou agonistique, dans lequel se complaît l’aristocratie, que la monnaie, peu à peu, dans un étrange mouvement de parturition, prend forme et tournure avant de voir le jour.
C’est dans le contexte de la formation de l’État et de l’émergence d’un pouvoir séparé qu’apparaissent : la division du travail avec des artisans (tisserands, orfèvres, forgerons, etc.) travaillant à temps plein ; l’échange marchand ; la monnaie. C’est dans une telle situation historique bien définie que prend forme le passage du don à l’échange marchand. Le maître vit encore dans l’univers du don [7] et de la générosité, il s’y accroche désespérément, mais il est amené à glisser doucement, insensiblement, de cet univers qui est encore le sien à celui du marchand, de l’univers de la largesse et de la libéralité à celui de la rétention et de l’accumulation. Dans son article déjà cité, Louis Gernet évoque ce glissement de l’idée de valeur qui passe peu à peu de la personne et même de la collectivité (du clan ou de la tribu), évoquant la notoriété du guerrier ou du clan, à la richesse mesurée en possessions, en biens de prestige. De la réalité à l’apparence, et l’on voit peu à peu l’apparence prendre le pas sur la réalité, sur la pensée elle-même, sur l’esprit.
☀
La rivalité entre chefs kwakiutl et entre les clans trouve son expression la plus forte dans la destruction des biens qui constituaient la richesse du clan. Un chef brûle des couvertures, un canoë ou brise un cuivre, indiquant par là qu’il ne fait aucun cas des biens matériels qui constituaient sa richesse et celle du clan, que sa richesse est spirituelle, montrant ainsi que son esprit est plus fort, son pouvoir spirituel plus grand que ceux de son rival. Si ce dernier et son clan ne sont pas capables de détruire un montant égal de biens dans un délai très court, leur nom est « cassé ». Ils sont vaincus, le chef rival et son clan perdent leur influence dans la tribu, tandis que le prestige de l’autre clan et de son chef augmente de façon proportionnelle. Un chef peut casser son cuivre et donner les bouts cassés à son rival. Si ce dernier veut conserver son prestige, il doit casser un cuivre de valeur égale ou plus élevée puis retourner à son rival à la fois le cuivre cassé et les fragments qu’il a reçus de celui-ci. Le rival « paie » alors le cuivre qu’il vient de recevoir. Cependant le chef à qui les fragments du premier cuivre ont été donnés peut aussi, dans un geste de défi, briser son cuivre et jeter les deux dans la mer [8]. Il signifie ainsi que pour lui et pour son clan la valeur n’est pas contenue dans l’objet, qu’elle est un au-delà de l’apparence.
Ce qui qualifie l’objet de valeur, c’est qu’il peut être risqué dans un pari grandiose, mettant en jeu, par le biais de l’objet de valeur ainsi risqué, la force spirituelle, autant dire la valeur humaine, de la personne (ou du clan, ou de la tribu) qui, dans cette destruction totale, montre qu’elle ne s’attache pas à l’objet en tant que tel, mais à ce qu’il représente, à l’esprit du don — à sa spiritualité, valeur humaine par excellence —, qu’il ne s’attache pas à l’apparence mais bien à la réalité, qu’il ne s’attache pas à l’apparence de l’esprit mais à sa réalité. Tout objet de valeur peut ainsi être mis en jeu, plaques de cuivre ou argent. Dans son article, Louis Gernet [9] évoque une scène un peu semblable, il s’agit de la légende concernant l’anneau de Polycrate. Polycrate est un tyran de la seconde moitié du VIe siècle. Nous n’avons plus affaire à des chefs de clan, mais à des rois ou des tyrans à la tête d’une société duelle partagée entre une aristocratie guerrière et domaniale qui se veut conquérante et la population autochtone.
Polycrate dont le bonheur sans mélange est une provocation à la jalousie des dieux reçoit le conseil de se dépouiller « de l’objet qui a le plus de valeur pour lui ». Il jette donc à la mer, au cours d’une cérémonie, le fameux anneau qui est l’objet auquel il tient le plus. Mais l’anneau, contre toute attente se retrouve, il est rejeté par la mer et par les dieux. La renonciation qu’avait consentie Polycrate n’a pu s’accomplir : une ruine totale peut seule expier une richesse trop continue en biens matériels. La scène peut bien rappeler celle où le chef de clan kwakiutl jette son cuivre à la mer, imperceptiblement des changements significatifs se sont produits. Elle rappelle aussi la lutte de prestige entre les deux rois, Minos et Thésée : Minos lance son anneau à la mer et somme son rival d’aller le chercher. Dans la première scène, celle du chef kwakiutl, il n’est pas question de dieux, ou des dieux mais bien d’une rivalité entre hommes et plutôt entre clans, il y a bien de l’esprit dans l’air mais cette spiritualité n’a pas encore pris une tournure religieuse pour se cristalliser dans la figure d’un dieu. Minos en appelle à Zeus et Thésée à Poséidon. Polycrate suscite la jalousie des dieux, à la tête de la société, il est bien seul, riche mais seul, et il est bien incapable d’aller jusqu’au don total, jusqu’à la destruction complète de ses biens matériels. Ce sont les dieux qui s’en chargent et provoquent sa ruine.
L’esprit est la réalité, le cuivre ou l’anneau ne sont que des apparences. S’il veut connaître la réalité de l’esprit, Polycrate doit détruire tout ce qui constitue sa richesse, qui n’est qu’apparence. Il en est bien incapable, la séparation, avec le clan ou la tribu, avec l’humain, est consommée. Cependant l’idée du don total hante toujours les rois grecs à la fin de l’époque archaïque, mais ce don total, qui signifie leur couronnement par l’esprit et la reconnaissance des dieux, ne fait que les hanter. L’anneau est le symbole du pouvoir et celui de la consécration des dieux, comme la plaque de cuivre, il symbolise et représente toute la richesse (en biens, en possessions, en couvertures ou en canoës), richesse présente ou promise. Pourtant si le pouvoir se confond avec la richesse, le pouvoir véritable comme la richesse véritable ne se trouvent pas dans la chose même, dans l’accumulation du pouvoir avec l’accumulation des biens, mais dans la destruction, dans le don, dans le potlatch. C’est le big-man contre le roi, les big-men des temps obscurs (du XIIe au IXe siècle) contre les tyrans ou les nouveaux rois qui font leur apparition en Grèce à la fin du IXe et au début du VIIIe siècle.
Encore une fois, je retrouve le lien entre le pouvoir et la richesse, entre la naissance de l’État en tant que pouvoir séparé et l’argent, entre pouvoir et capital. Les légendes grecques insistent avec une certaine redondance sur cette relation. L’aurions-nous oubliée ?
Louis Gernet complète cette légende par un autre exemple, celui de l’anneau de Gygès. Gygès est un berger qui découvre un trésor et dans ce trésor se trouve un anneau qui lui permet d’être invisible s’il tourne le chaton de son côté. Il tue le roi de Lydie et prend sa place. En mettant en relation le chaton de la bague et le sceau de la royauté, Louis Gernet en arrive à cette conclusion fort intéressante pour nous : « Ce qui est certain c’est que le sceau est en rapport direct avec les plus anciennes monnaies, où il est l’antécédent de la frappe : il est une attestation et plus précisément une marque de propriété — pourvu, à ce titre, d’une vertu primitivement magique. [10] » Si nous suivons avec attention ces légendes, nous pouvons avancer que peu à peu l’apparence prend le pas sur l’esprit, la représentation sur la chose représentée, l’objet de valeur sur la valeur elle-même, ce glissement se fait imperceptible, mais c’est l’idée même de richesse qui est en jeu : richesse constituée de biens matériels, de biens dits de prestige que l’on accumule en tant que capital ou richesse spirituelle ?
Nous voyons bien dans cette histoire que le pouvoir en tant que pouvoir séparé se trouve lié à l’apparence, aux biens possédés, et que c’est l’accumulation de biens, ce que l’on nomme en langue vulgaire le capital, qui le constitue. L’esprit se trouve-t-il dans la chose même ? Le mana se trouve-t-il dans l’objet qui le représente ou l’évoque ? La valeur se trouve-t-elle dans l’argent, dans la monnaie ? Questions sans réponse ou bien alors la réponse serait-elle contenue dans le défi ? Dans le cuivre jeté à la mer ? Dans l’argent flambé au cours d’une partie de dés mémorable ? Dans le suicide des banquiers ?
Le don laisse encore la part belle au défi, au risque, à la destruction sans retour et pourtant, à chaque fois, le défi est relevé, un partenaire se présente qui se dit humain lui aussi, c’est l’esprit du don, la liberté, la circulation, la ronde, la danse dans les étoiles. L’esprit marchand, c’est autre chose : c’est l’obligation du retour, c’est la sécurité, c’est l’obligation du travail, c’est l’esclavage. Faut-il attendre de mourir pour tout perdre et danser dans les étoiles ?
☀
Marseille, le 24 août 2018
Georges Lapierre

 lavoiedujaguar.net
lavoiedujaguar.net