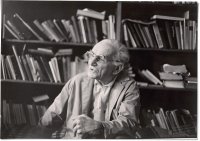F.J. Raddatz : Je vois dans l’ensemble de votre travail une contradiction très complexe ; cette contradiction se présente à moi en trois éléments, à vrai dire difficilement conciliables. D’une part vous dites : « Quoi que nous fassions, c’est toujours plus ou moins en vain. » D’autre part l’ensemble de vos travaux ne fait que présenter le contraire, qui est de lutter contre ce « en vain », changer tout de même quelque chose, créer une conscience, au moins combattre l’analphabétisme mental, moral aussi. Mais, j’en viens au troisième point, vous dites quelque part que l’être humain est, c’est votre expression, « contingent ». Comment prétendez-vous relier ces trois éléments très contradictoires ?
G. Anders : Non, je ne dirais pas qu’il y a là des contradictions ; ce sont tout au plus des contradictions apparentes. S’il m’arrive très souvent d’affirmer, de façon exagérée, que rien ne sert à rien, c’est en fait pour des raisons tactiques, à savoir pour m’opposer à ces hommes politiques et à ces journalistes du happy end, qui ne craignent pas de faire dans l’optimisme. Le mot « espérance », à travers Ernst Bloch, a malheureusement pris un caractère de solennité — pour tout le monde, même pour le plus réactionnaire des hommes politiques. Naturellement, de cet épais volume du Principe Espérance, ils n’ont lu que le titre. Au demeurant, l’espérance n’est absolument pas un principe, mais une émotion justifiée. Si je suis — pour utiliser cette expression triviale — très « pessimiste », c’est pour lutter contre cet optimisme rayonnant, que l’on rencontre même chez ceux qui sont au courant de la situation nucléaire. Au fond, ce que je prêche — mais je sais que par là j’en demande beaucoup à la moyenne des gens, peut-être beaucoup trop — c’est, dans la pratique, de faire des efforts comme s’ils ne savaient pas combien nos chances sont minimes. C’est-à-dire de mettre en pratique une schizophrénie morale. Dans notre rôle d’actifs en matière de morale, nous avons à nous faire plus bêtes que nous ne sommes.
F.J.R. : Est-ce-que vous entendez maintenant par « actif » — comme dans cette conversation avec Heidegger que vous citiez — quelqu’un qui a « déserté vers la pratique » ?
G.A. : Jamais dans ma vie je n’ai conçu le « faire » comme un acte de désertion. C’est vrai que j’ai déjà « déserté vers la pratique » peu avant la prise de pouvoir par Hitler. Mais que veut dire au juste « déserter » ? Je trouve au contraire : les déserteurs sont ceux qui ne prétendent pas déserter, ceux qui, quand les camps de concentration existent, continuent, en universitaires, à peaufiner leurs « Contributions à l’étude de tel ou tel sujet, compte tenu de tel ou tel aspect particulier ». Ceux-là désertent effectivement, vers le domaine de l’irresponsabilité.
F.J.R. : Vous voulez donc dire que votre travail est de la pratique ? Vous ne faites pas de séparation entre une marche de protestation et votre travail théorique d’écriture ?
G.A. : Pas plus qu’entre la recette de l’escalope et sa dégustation. — Croyez-vous peut-être que je sois allé à Hiroshima comme « théoricien » ? Ou mieux : « en ma qualité de théoricien » ? Laissez-moi rire ! Et la correspondance que j’ai échangée avec Claude Eatherly, ou avec Klaus Eichmann, ce serait comme théoricien ? Et mon allocution pour l’appel de Krefeld, je l’aurais rédigée pour la bonne raison que je « m’intéresse à la problématique de la paix » ?
F.J.R. : Laissez-moi revenir à la question de « contingent ». Peu de gens comprendront exactement ce que vous voulez dire. Et je trouve moi-même que cela peut facilement prêter à confusion, au regard de ce que vous venez de dire : votre vie, votre travail compris comme l’union de la pensée et de l’action dans une grande mise en pratique. Si dans le même temps vous faites de l’homme une monade sans fenêtre…
G.A. : Non, pas une monade sans fenêtre. Le concept de « contingent » est apparu chez moi pour la première fois en 1929, dans la conférence que j’avais faite à la société Kant sur « L’étrangeté de l’homme au monde » ; j’y parlais de la « contingence de l’homme ». Cela signifie qu’il fait partie des créatures dues au hasard ; que l’on peut penser un monde dans lequel l’homme n’existerait pas. L’existence de l’homme est tout autant le fait du hasard que celle de l’épinard ou du flet. J’ai formulé cela avec cette netteté et cette impertinence, pour engager une polémique sur la thèse vaniteuse et immodeste qui veut que nous ayons été créés à l’image de Dieu. Souligner la contingence est en fait se déclarer contre la nécessité de l’existence de l’homme sur Terre.
F.J.R. : Pardonnez-moi, Monsieur Anders, et laissez-moi m’entêter. Me voilà à présent aussi bête que ce professeur de Paderborn que vous citiez dans les Ketzereien (Hérésies). Vous vous référez à cette lettre et vous écrivez que l’homme n’est pas « plus digne de réflexion philosophique » qu’une méduse ou une ortie, par exemple. Plus digne de réflexion philosophique, il vous faut d’abord redéfinir l’expression.
G.A. : Je trouve que c’est une terrible prétention de croire que nous précisément, qui sommes tout simplement des hommes, nous avons une autre valence métaphysique que les millions d’autres creata, c’est-à-dire les autres créatures et les autres choses créées, qui existent de par le monde.
F.J.R. : Quand vous dites, pas plus de valence, pas d’autre valence que…
G.A. : … pas d’autre valence métaphysique.
F.J.R. : … comment voulez-vous, alors, que votre bonne parole atteigne cette créature de hasard qu’est l’homme, si vous ne lui accordez pas d’autre valence que vous en accordez au brin d’herbe ou à l’ortie ?
G.A. : Mais je ne dis pas du tout que l’épinard ou l’ortie soient sans valeur.
F.J.R. : Je veux en venir au concept de culpabilité. L’homme a la faculté — au contraire de tous vos autres creata — de se rendre coupable. Au cours de ce siècle, il s’est rendu horriblement coupable ; ce qui n’est finalement rien d’autre que l’éternel sujet de vos livres.
G.A. : Mais enfin, la culpabilité n’est pas précisément une distinction. Devrions-nous nous vanter de notre faculté de culpabilité ?
F.J.R. : La valence est une valeur.
G.A. : Oui, une valeur. Mais c’est faire preuve d’une énorme vanité de croire que l’on est précisément l’existant par excellence, supérieur à toutes les autres espèces d’existant, c’est une immense…
F.J.R. : Outrecuidance (Hybris) ?
G.A. : Le mot outrecuidance me semble trop solennel. Non, c’est de la gueulardise métaphysique. Et se rendre coupable, ce n’est possible qu’à l’intérieur d’une certaine organisation de la vie d’un groupe. Voilà « ce qui distingue l’homme » : les loups ne peuvent pas se rendre coupables. Ils n’ont pas besoin de morale, non plus. Se rendre coupable n’est possible que dans un groupe qui a besoin de morale, parce qu’il n’a pas reçu de la nature les règles de comportement nécessaires.
F.J.R. : La possibilité de se rendre coupable, cela veut dire aussi la possibilité de se décider : pour le bien ou pour le mal. La possibilité de décision n’appartient-elle donc pas à l’essence de l’homme ?
G.A. : Non pas la possibilité de décision, mais la nécessité de devoir se décider, la nécessité de devoir disposer d’une morale, dont les animaux n’ont vraisemblablement pas besoin. Nous n’en savons rien. Nous ne pouvons pas demander aux abeilles si elles ont également certaines règles et si on les met à mort quand elles contreviennent aux règles. Il y a aussi bel et bien une forme de mise à mort chez les fourmis et les abeilles. Je ne ferais pas de la possibilité de se rendre coupable le signe de la supériorité…
F.J.R. : … ce n’était pas non plus l’objet de ma question, il s’agissait de « l’être-fait-autrement ». C’est à cela que je veux en venir. Que l’homme est fait différemment, qu’il se distingue en cela de l’ortie, de la méduse…
G.A. : Probablement. Nous n’en savons rien. J’admettrais de dire que nous nous distinguons par le fait que notre instinct est plus faible que chez les autres êtres vivants, et que nous tentons après coup d’établir une règle au moyen d’injonctions et d’interdits. Il est probable que ce n’est pas le cas chez les chiens ou les renards. Mais cela ne signifie pas que nous soyons placés au-dessus d’eux. Cela signifie par contre que nous avons malheureusement besoin d’une morale. La capacité à faire la part du bien et du mal n’est pas une distinction, mais un besoin absolu. L’épinard n’est pas moindre que nous parce qu’il n’a pas cette faculté. Il serait bien stupide, lui qui ne peut être ni bon ni mauvais, de faire une distinction qui n’aurait aucune signification pour lui, puisqu’il n’en a absolument pas besoin. Nous, en revanche, nous avons besoin de morale.
F.J.R. : De morale — est-ce vous le maître ?
G.A. : Oui, c’est moi.
F.J.R. : Quels ont été les maîtres de ce maître ? C’est assez déconcertant, car plus on vous lit, plus on voit apparaître de noms — que d’ailleurs vous finissez généralement par rejeter —, mais on n’arrive pas à distinguer exactement si vous avez réellement des maîtres ou si vos lectures vous ont simplement entraîné au hasard, à travers l’histoire du monde.
G.A. : Mes lectures, comparées à celles de certains érudits, ont été insuffisantes. J’en ai convenu à maintes reprises, lire m’est bien plus difficile qu’écrire, et entretenir des jardins qui ont été ensemencés par d’autres infiniment plus pénible que de sarcler, de semer ou de moissonner dans mon propre jardin. Quels ont été mes maîtres ? Du seul point de vue biographique, la réponse est facile : ce furent d’abord mon père et Ernst Cassirer, puis il y eut Edmund Husserl et Martin Heidegger ; avec Max Schleier, ce n’était déjà plus un rapport maître-élève, nous avons beaucoup discuté, encore que ce ne fût pas d’égal à égal, car j’étais beaucoup trop jeune pour cela. Comme d’ailleurs tout au long de mes études, où je n’étais qu’un gamin. Je n’avais que vingt et un ans, en 1923, lorsque j’ai passé ma thèse de doctorat avec Husserl. Un travail dirigé contre lui, soit dit en passant.
F.J.R. : Vous avez fait à plusieurs reprises des remarques sur Bloch, qui étaient des critiques, voire des attaques contre lui. Pas seulement contre son Principe Espérance, mais de façon plus générale à propos de son œuvre.
G.A. : Pas à propos de l’œuvre, mais contre sa manie de l’espérance. Cela tient à la situation nucléaire : il a refusé d’en prendre acte. J’ai essayé maintes fois — il faut dire que nous étions intimes — de lui faire comprendre que la disparition totale du monde était une éventualité incontestable, que la vraie révolution, c’était une humanité capable de se détruire elle-même et qu’au regard de cet énorme changement de situation, non seulement pour l’homme, mais aussi pour toute vie, les distinctions que nous autres marxistes avions établies entre les systèmes de domination, et même entre les classes sociales, devenaient secondaires. Pour finir, j’avais dit que, compte tenu de ce changement, il nous fallait réviser les fondements de notre philosophie, et même de notre réflexion philosophique marxiste. Et là, il a toujours eu le même geste de refus. Ma correspondance avec Eatherly, il la trouvait larmoyante et inepte. Et cette attitude désespérément tournée vers l’espoir, lâche au fond, m’a peu à peu profondément contrarié. De là les remarques critiques à son encontre. Mais n’oubliez pas que je lui ai dédié un livre. Nous étions très amis.
F.J.R. : Et avec Adorno ou Horkheimer ? L’École de Francfort est un concept qui, curieusement — pour autant que je puisse en juger en tout cas —, n’apparaît jamais chez vous.
G.A. : C’est qu’elle n’a eu chez moi aucun rôle de formation. Pensez qu’Adorno était beaucoup plus jeune que moi. J’avais commencé bien avant lui, mais ses écrits n’ont joué pour moi qu’un rôle minime. Il faut dire aussi que, après avoir quitté Fribourg, je me suis d’abord trouvé à Berlin. Ensuite, je suis allé à Paris, où j’ai d’avantage fréquenté des artistes.
F.J.R. : À Paris, vous avez rencontré entre autres Walter Benjamin.
G.A. : Benjamin n’est pas pour moi un élément du cercle Adorno. Benjamin était mon arrière-cousin. Je le connaissais depuis que j’étais au monde. Je ne peux pas dire qu’à Paris nous ayons fait de la philosophie ensemble. Car nous étions en premier lieu des antifascistes, en deuxième lieu des antifascistes, en troisième lieu des antifascistes et il se peut, en outre, que nous ayons parlé philosophie. Vous vous faites une image un peu fausse de l’émigration, si vous pensez que nous avions le temps de nous asseoir pour spéculer. Adorno et Horkheimer, peut-être, avaient du temps pour cela, parce que leur existence était assurée. Adorno et Horkheimer, c’est sûr, n’ont jamais éprouvé la misère de l’émigration. Je ne peux pas me rappeler avoir « philosophé » avec des écrivains allemands au temps de l’émigration.
F.J.R. : Peut-on aller jusqu’à dire que même plus tard l’émigration, même l’émigration américaine, fut pour vous une situation d’absence de dialogue, essentiellement ?
G.A. : Absence de dialogue philosophique ? Oui, j’accepterais cette expression. Pendant l’émigration en Amérique, j’ai habité un temps dans la maison de Herbert Marcuse à Santa Monica ; mais même Marcuse et moi, nous n’avons, à proprement parler, pas « philosophé » ensemble. Je n’avais ma place nulle part. Je n’étais plus heideggérien, et ce depuis bien des années, je ne faisais pas partie du cercle d’Adorno et Horkheimer, je n’ai jamais été membre de l’Institut de Francfort et je n’étais pas inscrit au Parti. À vrai dire, on ne me prenait pas au sérieux : Brecht ne me prenait pas au sérieux, parce que ma philosophie n’était pas assez marxiste ; et les universitaires non plus, parce que je ne me contentais pas de philosopher en érudit sur la philosophie des autres — ils ne me comprenaient pas quand je déclarais qu’un astronome ne s’occupe pas en premier lieu des théories astronomiques d’autres astronomes, mais des étoiles […].
F.J.R. : Et Brecht ? Vous avez quand même publié ces conversations avec lui, qui, je suppose, ne sont pas purement fictives — cela veut donc dire que vous l’avez bien vu de temps à autre ?
G.A. : Fictives ? De temps à autre ? Très souvent ! Cela avait commencé à Berlin déjà. À Berlin, je lui rendais régulièrement visite et c’était une situation des plus délicates. Car en fin de compte, je crois bien qu’il ne pouvait pas me sentir. Pas seulement parce que je le comprenais mieux qu’il n’aurait souhaité, mais aussi parce qu’il avait l’habitude de s’entourer de gens dont il pouvait « obtenir quelque chose », qui lui étaient utiles. L’utilité était le critère du choix de ses relations. Ce qui signifiait : subordination. Et c’était une chose pour laquelle j’étais désespérément peu doué. […]
F.J.R. : Peut-on dire que beaucoup de vos travaux — je pense aux fables Der Blick vom Turm (La vue du haut de la tour) — sont très proches du modèle d’écriture brechtien ?
G.A. : Que j’ai été influencé par Brecht, par exemple par les Histoires de Monsieur Keuner, et aussi par son « mélange de sagesse et d’insolence », comme il a dit un jour, cela ne fait aucun doute. Il a sûrement été important aussi pour ma réflexion philosophique, quoiqu’il ait été tout à fait inculte en philosophie. À vrai dire, il ne connaissait que le marxisme. Hegel même, seulement par ouï-dire. Peu après que nous ayons lié — comment dire cela : connaissance est bien trop faible, amitié bien trop fort —, il avait fait une espèce de remarque sur l’« idéalisme » de Hegel. Il se servait de ces expressions stéréotypées sans complexes. Il ajouta que Hegel « n’entrait absolument pas en ligne de compte » et qu’en lisant Marx à côté on voyait bien « quelle force formidable » c’était.
Lorsque je vins chez lui la fois suivante, je lui dis : « J’ai apporté un texte de Hegel et un texte de Marx, que je vais vous lire ; je suivrai l’ordre chronologique, c’est-à-dire que je commencerai par Hegel. » Mais je lus Marx. Il commença à ironiser. Puis je lus Hegel en déclarant que le texte était de Marx. Cela lui plut énormément. Vous savez, déjà à cette époque, alors qu’il avait tout juste vingt-cinq ans, Brecht était habitué à être célébré, porté aux nues. Même les hommes le traitaient comme l’auraient fait les femmes. Ce que j’avais fait là était une insolence à laquelle il n’avait encore jamais été confronté (et qui pourtant était assez brechtienne). Lorsque je lui avouai la supercherie, il me mit à la porte. Par la suite nous nous sommes réconciliés. Je suppose qu’il a pris conscience de l’intention didactique qui était derrière ce tour de passe-passe. Il était extraordinairement ouvert aux plaisanteries, en faisait lui-même énormément, et cette astuce pour « l’avoir au tournant » a dû lui plaire en secret, finalement. […]
F.J.R. : Votre philosophie, qu’est-ce-que c’est ? Il y a votre mot de « philosophie du décalage » (Diskrepanzphilosophie).
G.A. : C’est la réponse que j’avais faite à quelqu’un qui me demandais un jour comment j’intitulais ma philosophie. Je lui avais répondu : au centre de mon anthropologie philosophique se trouve vraisemblablement le fait déterminant de la non-synchronisation des capacités humaines, et même de leur décalage. Le fait que nous pouvons d’avantage produire que représenter. C’est de là que viendra éventuellement la catastrophe. Si l’on veut donc absolument trouver un nom à ma réflexion philosophique, il faut le faire par rapport à ce décalage entre production et représentation, appelons-la donc « philosophie du décalage ». Cela semblait d’autant plus approprié qu’il existe une fameuse « philosophie de l’identité », celle de Schelling. Alors, « philosophie du décalage », cela fait un joli pendant.
F.J.R. : Naturellement, personne ne saura avec ces quelques phrases ce qu’est au juste la « philosophie du décalage ».
G.A. : On ne le sait pas d’avantage avec la « philosophie de l’identité ». Est-ce l’homme qui est identique à Dieu ou bien est-ce le corps qui est identique à l’âme ? Et « l’idéalisme transcendantal » non plus, on ne sait pas ce que c’est.
F.J.R. : Mais vous devez me l’expliquer, et l’expliquer à nos lecteurs.
G.A. : Un titre est un panneau indicateur, pas un descriptif. Le panneau indicateur n’est pas tenu de représenter toute l’auberge dont il montre la direction. Peu importe. Ce qui se répète dans tout ce que j’ai écrit, c’est que le décalage qui définit l’homme actuel — et pas seulement actuel, disons plutôt : qui est la destinée de l’homme, ce décalage n’est plus identique à ceux qui passaient jusqu’ici pour déterminants. Le décalage entre chair et esprit, entre désir et devoir, aujourd’hui, nous pouvons nous en moquer. Ce qui compte aujourd’hui, c’est plutôt le décalage entre ce que nous sommes capables de faire et ce que nous sommes capables de représenter. C’est uniquement parce que nous sommes incapables de représenter nos produits et leurs effets, que rien ne nous retient de fabriquer des bombes atomiques. Mais ce que je pense, c’est que nous sommes devenus des « utopistes inversés » : alors qu’eux étaient capables de représenter bien plus qu’ils ne pouvaient produire, nous pouvons malheureusement nous représenter infiniment moins que nous pouvons produire. C’est seulement parce que ce décalage sera cause de notre disparition — au fond, la raison n’est pas si mince — que j’ai donné ce nom à ma philosophie.
À cela s’ajoute un deuxième décalage, apparenté de très près, il est vrai, au premier : le décalage entre ce que nous appelions autrefois « notre activité », « notre faire », et ce que nous « faisons » aujourd’hui réellement. En réalité, nous ne « faisons » effectivement plus rien, au sens de « agir » ou « produire ». Nous nous contentons au contraire (pour autant que nous en soyons les acteurs) de simples actes de déclenchement, entraînant des résultats que non seulement nous ne pouvons pas nous figurer, mais que même nous ne pouvons plus identifier. Le décalage entre déclenchement et effet est un phénomène absolument nouveau, absolument catastrophique. On ne peut même plus le décrire par des mots tels que « aliénation » ou « distanciation », car ces termes supposent que l’on confère après coup de la distance à quelque chose qui, auparavant, nous était familier. Mais ce n’est pas du tout cela qui est en cause. L’ouvrier ou l’homme politique d’aujourd’hui ne fait pas tout à coup, de quelque chose qui était familier auparavant, quelque chose d’étrange, il se trouve au contraire d’emblée dans un état d’étrangeté face au résultat de son activité, puisqu’il ne pense absolument pas au résultat qu’il va obtenir.
Quand vous travaillez sur une machine comme j’ai travaillé sur une machine, ce qui en sort ne vous est pas seulement parfaitement égal, vous ne l’avez jamais sous les yeux comme eidos, pour le dire en grec, et cela n’aurait d’ailleurs aucun sens d’avoir l’eidos sous les yeux. On travaille donc sans telos [sans but] et sans eidos [sans idée]. Le décalage entre le producteur et le produit est total. C’est ce décalage qui représente la véritable révolution de notre époque. La véritable, car elle est parfaitement indépendante du modèle économique et se fait, s’est faite, à l’Ouest comme à l’Est.
F.J.R. : Sauf dans les deux « résultats » spectaculaires de l’histoire, qui ont chez vous continuellement la vedette, je veux dire Auschwitz et Hiroshima. Là, on voit parfaitement le résultat du faire. Et en dépit de l’éloignement par rapport au produit, que vous avez défini, ces produits sont pourtant bien fabriqués : il faut bien que l’un mélange le gaz, que l’autre construise la bombe. Il y a bien un scientifique pour la concevoir, un technicien pour la monter, et pour finir, un pilote pour la larguer. Pensez-vous pouvoir jamais interrompre cet enchaînement de cause à effet ?
G.A. : Probablement pas. Mais je crois malgré tout que nous n’avons pas d’autre devoir que d’attirer au moins l’attention des gens sur le fait qu’ils mènent leurs activités sans telos, mais qu’il en ressort finalement un telos qu’ils n’avaient pas voulu, c’est-à-dire la disparition de l’univers.
F.J.R. : Est-ce, entre autres, la raison pour laquelle, dans la préface de Mensch ohne Welt (L’homme sans monde), vous vous prononcez, de façon réellement déconcertante, contre le pluralisme ?
G.A. : Vous passez là hardiment à un autre champ d’interrogations. Pour répondre à votre question : j’ai toujours été déconcerté d’être le seul qui fût déconcerté par le pluralisme. C’est réellement un état déroutant que de devoir participer à tout, tout respecter de façon égale, mais sans y croire. C’est une situation absurde. Cela n’a jamais existé, hormis dans la culture alexandrine. À mon avis, c’est le résultat de la commercialisation du monde — un élargissement du concept de tolérance que les fondateurs de l’idéal de tolérance ne pouvaient certainement pas prévoir.
F.J.R. : Mais Günther Anders, pardonnez-moi, voilà quelque chose qui devient très délicat. Je connais votre thèse, qui dit que le droit à l’égalité fondamentale de notre époque est celui de la production de marchandises. J’y opposerai un grand « mais » : vous comme moi, et bien d’autres encore. Nous vivons aussi de ce concept de tolérance, disons, élargi. Nous sommes à beaucoup d’autres aussi insupportables que beaucoup d’autres nous sont insupportables. Qui va décider comment il faudrait délimiter le pluralisme, circonscrire la tolérance ? C’est plutôt délicat.
G.A. : En effet, aborder ce problème est extraordinairement délicat. Je n’ai pas proposé que nous abandonnions le pluralisme pour nous saisir brusquement d’une religion ou d’un dogme déterminé — ce qui serait revenir à une intolérance déterminée.
F.J.R. : Je lis une phrase extraite de Mensch ohne Welt : « Mais manifestement, le pluralisme, par nature, non seulement ne souffre pas de ne plus vivre dans un monde déterminé, mais encore ne sent même plus combien la vérité lui est devenue indifférente. » C’est un peu fort.
G.A. : Cela vaut déjà pour Nathan. Et plus que jamais pour aujourd’hui. Vous ne connaissez pas le concept de tolérance extrême développé par la « troisième école de psychanalyse » dont on doit l’existence — une existence quelque peu ridicule — à Viktor Frankl ? On y affirme qu’il est parfaitement indifférent quel idéal quelqu’un peut avoir. Tant qu’il en a un, quel qu’il soit, sa vie a un sens (pour autant que ce mot ait ici un sens quelconque). Et ce quelqu’un devrait alors rester en bonne santé, voire guérir. La vérité n’est donc pas décisive. Seulement la sincérité. Non, même pas cela, encore. Mais simplement l’effet thérapeutique d’une prise de position. Cette thèse, qui veut que la force d’une croyance rende vrai son objet, est insupportable.
F.J.R. : Je vous l’accorde. Car cela voudrait dire en effet que tous les nazis qui ont cru sincèrement au national-socialisme ont cru à quelque chose de vrai. Mais où tracer la frontière ? Vous dites à un autre endroit que l’on peut poser la question : est-ce que la tolérance est antidémocratique, ou n’est-elle pas même un manque de culture ? Bon, encore cette seconde hypothèse ne nous empêcherait-elle pas de vivre. Je trouve par contre que c’est l’intolérance qui est un manque de démocratie. Et on y vient vite. Si vous refusez le pluralisme as such, où se situe votre concept de la tolérance, que vous réclamez pourtant pour vous-même, lorsque vous demandez que l’on tolère votre « moi ». Qui va déterminer cela ?
G.A. : Pour répondre à cette question, il faudrait tout un traité sur le rapport entre « Morale et Vérité ». Je ne peux pas vous le produire en un tournemain. Mais dans mon introduction à Mensch ohne Welt, j’ai pris clairement mes distances à l’égard de ceux qui, par scepticisme vis-à-vis du pluralisme, décident, comme c’est maintenant la mode, de se cantonner à un dogme intégriste quelconque, peu importe lequel, d’y adhérer ou d’y revenir, et qui attendent des autres la même conversion. Le refus que je préconise, d’un polythéisme sans aucun engagement, se réduit-il donc nécessairement à approuver en renégat un quelconque « monothéisme » ? Ne peut-on mettre en cause la légitimité d’une situation que si l’on est capable de définir sans ambiguïté la situation qui devrait prévaloir à sa place ? Est-ce que ce ne serait pas la mort de toute critique ?
Il me semble que ma présentation de Kultur als Inbegriff des Unverbindlichen (La civilisation comme incarnation du non-engagement) garde son importance, même si je n’ai aucun engagement à formuler solennellement. En tout cas, je n’ai pas fait comme nombre de mes contemporains, qui adhèrent tout à coup à quelque intégrisme, qu’il soit islamique ou juif, ou qui, pour appartenir au moins à quelque chose, se font disciples de Baghwan. Ce n’est pas là ce que je propose. Tout cela, ce ne sont que des expédients. Mais le fait que je n’ai pas de solution ne m’ôte ni la possibilité ni le devoir de critiquer l’absurdité d’une culture qui est devenue commerciale, et que l’on a voulue telle.
F.J.R. : Vous affirmez aujourd’hui avec force : je ne suis pas intégriste, je ne le suis pas devenu et ne l’ai, à l’évidence, jamais été. On est pourtant frappé de voir comme vous vous êtes inlassablement occupé de — je choisis pour l’instant une formule très brève — de Dieu, vous pouvez employer aussi le terme de religiosité. Vous cernez le problème dans presque tous vos livres.
G.A. : Ça, je peux vous l’expliquer. D’une manière qui me demeure impénétrable et suspecte, j’exerce sur les êtres religieux une certaine attraction. Manifestement, lorsque je parle d’Auschwitz ou d’Hiroshima, ma langue se charge d’une ferveur qui, sans en avoir l’onction, a certainement quelque chose d’un prêche, et qui est mal comprise. Un ecclésiastique protestant connu, décédé depuis, m’a lancé un jour : « Naturellement — ne me dites pas le contraire — vous êtes un homo religiosus ! » Ce que naturellement je ne suis pas ; je suis au mieux un honnête homme. Si je reprends sans relâche des « thèmes religieux », c’est pour combattre sans relâche les procès d’intention religieux. Les baquets d’eau froide qui sont à côté de ma table de travail ne témoignent certainement pas de mon « ardeur religieuse ».
F.J.R. : Mais ce n’est pas la réponse à ma question ; vous me faites une réponse tactique. Je voulais une réponse sur le fond. Je voulais vous entendre dire dans quelle mesure ces choses vous engagent à y réfléchir un peu plus avant, plutôt que de les rejeter ou de les balayer d’un revers de la main, comme on peut le faire pour y répondre. Il y a aussi, ce qui est bizarre de votre part, encore que vous l’ayez toujours contesté, cette expression d’« antéchrist de profession » ou quelque chose du genre.
G.A. : Athée professionnel. Le Christ n’est jamais mentionné, ou sinon, seulement sous le nom de Jésus.
F.J.R. : Mais Dieu est mentionné, et même assez souvent. C’est sur ce point que je vous interroge. Vous avez un jour essayé de vous définir vous-même à l’aide de nombreuses questions et négations : au fond, je suis un écrivain allemand, mais non, je ne suis pas un écrivain allemand, car j’ai vécu ici et là. Suis-je un écrivain juif ? Oui, c’est vrai, je suis juif, mais je ne suis pas un écrivain juif, et ainsi de suite.
G.A. : Ce n’est pas de ma faute si je suis devenu indéfinissable. C’est parce que l’histoire m’a rejeté hors de toutes frontières que je suis justement indéfinissable, que je vis justement sans fines, sans frontières définies.
F.J.R. : N’y aurait-il pas derrière vos plaintes sur l’infamie et le caractère criminel de l’histoire une sorte de requête ? Vous dites très souvent : comment pouvez-vous donc parler d’un Dieu, avoir l’idée d’en rêver, ou même de croire en lui ? En un Dieu qui permet Auschwitz et Hiroshima. Derrière cette question, derrière cette plainte, on entend bien aussi la requête il faudrait pourtant qu’il existe. Non ?
G.A. : Non. « Re-quête » est un joli jeu de mots, mais je ne vous accorderais pas que je suis en quête de quelque chose. Ma plainte, c’est que les hommes soient assez aveugles pour croire encore, après Auschwitz et Hiroshima. Je n’ai rien à attendre du monde. Je ne peux pas attendre qu’on se conduise de façon morale. Mais je n’accepte pas que le monde soit comme il est, et j’essaie de contribuer à éviter le plus effroyable.
F.J.R. : Vous avez dit un jour : « Je hais la haine », et dans un autre livre, vous avez consacré tout un passage à dire combien il est déplorable que l’on vous ait appris la haine. Il y a au fond derrière cela un grand amour, ou un besoin d’amour, ou bien encore une lamentation sur cette potentialité détruite à savoir aimer les hommes, le monde, le cours des choses.
G.A. : Là, vous avez peut-être raison. Et je n’ai pas aimé seulement tel ou tel être humain. Et pas seulement des êtres humains. Car il n’est pas un arbre que je n’aimerais appeler par son prénom ; et pas un animal, auquel je ne donne aussitôt un nom câlin. D’ailleurs, à chaque fois, on n’aime pas seulement « l’objet » de son amour, on aime aussi aimer.
F.J.R. : J’espère que ce n’est pas une question saugrenue : votre affinité avec Beckett vient-elle de là ? De ce qu’il montre l’impossibilité du nihilisme ?
G.A. : Si je me souviens encore bien de En attendant Godot, c’est ce qu’il fait, effectivement. Car ses « héros » continuent à attendre la venue de Godot en dépit du fait que lui, faute d’exister, ne songe pas le moins du monde à réaliser leur rêve. Eux, qui attendent, sont donc incapables de vivre dans le nihilisme, incapables de ne pas espérer. Mais Beckett ne s’identifie pas avec ces personnages, ses personnages ; il ne tient pas pour vertu, et pas davantage pour preuve de l’existence de Godot, leur incapacité à ne pas attendre, donc à ne pas espérer. Comme je vois, tout comme lui, un manque dans cette incapacité — vous connaissez bien ma position par rapport à la manie d’espérance de Bloch, pour moi espérance est tout simplement synonyme de lâcheté — l’affinité entre Beckett et moi est effectivement incontestable.
F.J.R. : Est-ce-que cela n’est pas en contradiction avec votre affirmation que l’engagement est inhérent et essentiel à l’œuvre d’art ? Beckett n’est vraiment pas un écrivain engagé.
G.A. : Je ne choisirais pas une formule aussi catégorique. Je dirais qu’il n’y a rien de plus ridicule que l’idéal du non-engagement, et que cet idéal ridicule ne prévaut que dans le domaine de l’art. Aucun pasteur ne comprendrait qu’on dise de lui qu’il n’a pas d’engagement ou qu’il ne prend pas son engagement au sérieux. Aucun boulanger ne vous comprendrait si vous lui faisiez ce reproche : « Vous êtes un boulanger engagé, puisque vous faites vos petits pains pour nourrir les hommes et pour vous engraisser en nous rassasiant. » Il n’y a effectivement que l’art pour avoir rendu ainsi l’engagement ridicule.
F.J.R. : Pour vous, l’art a donc une fonction dans ce qui se passe au sein de la société ?
G.A. : Can’t help having it. [Je ne peux pas empêcher qu’elle en ait une.]
F.J.R. : Dans le même temps, vous ne cessez de paraphraser la formule d’Adorno selon laquelle, après Auschwitz, on ne peut plus écrire de poèmes, dans le sens : on ne « devrait » plus écrire de poèmes. Mais alors, si l’art est une valeur sociale, il n’a évidemment pas le droit de s’arrêter après Auschwitz. Je trouve cette formule d’Adorno totalement erronée.
G.A. : Moi pas. Je crois que le prétendu sérieux de l’art, au regard du sérieux de ce qui s’est passé, et de ce qui menace, n’est que frivolité. Il est des événements d’une telle importance que l’art ne peut y atteindre. Rien de plus inconvenant que la composition de Schönberg Un survivant de Varsovie ; et cela vaut malheureusement aussi pour le Sul ponte di Hiroshima que Nono a tiré de mon livre Der Mann auf der Brücke (L’homme sur le pont). Dans les deux cas, on fait de l’horreur de ce qui est arrivé, et de ce qui peut encore nous atteindre, un sujet de jouissance. Ce n’est pas sérieux. Adorno ne dit pas on ne doit pas, mais on ne peut pas.
F.J.R. : Vous-même, vous faites des poèmes.
G.A. : Je n’ai jamais fait de poème sur Hiroshima.
F.J.R. : Adorno n’a pas dit non plus : plus de poème sur Auschwitz. Il a dit : plus de poème après Auschwitz.
G.A. : Je ne crois pas en avoir fait un seul après. Ma muse, même si ce ne fut pas instantané, est morte d’effroi. Depuis que je suis revenu en Europe, quasiment aucun poème n’a vu le jour.
F.J.R. : Mais vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça, Günther Anders ! Vos fables aussi sont des poèmes. Ne vous accrochez pas au seul mot de « poème ». Vous venez vous-même de citer les travaux de Schönberg ou de Nono, comme autre forme d’art possible. Avec le mot « poème », Adorno ne pense pas au poème, mais à l’art.
G.A. : Je n’ai, je crois bien, écrit aucune fable à propos d’Hiroshima.
F.J.R. : Nous ne disons pas à propos de. Nous disons après Auschwitz. Il met une date. Il a dit : après qu’il est arrivé quelque chose d’aussi effroyable, l’art devient du batifolage. C’est ce que dit la phrase. Et je la trouve stupide ; car naturellement, la Todesfuge de Celan est un poème important.
G.A. : Non, je ne le crois pas du tout. Je crois plutôt qu’on a voulu nous en persuader. Son poème a servi d’alibi aux Allemands, c’était un moyen de « surmonter » et d’« admettre » Auschwitz sous la forme d’une poésie d’avant-garde. Cette Todesfuge reproduite à des milliers d’exemplaires n’a jamais été comprise de quiconque. Même pas de Celan lui-même. Jamais ce poème n’a eu un « effet », jamais il n’a réellement déclenché angoisse et terreur. On ne peut pas le réciter. Et si on le récite quand même, il devient un objet décoratif proprement scandaleux. En cela, Adorno avait donc raison. Ce qu’il voulait dire, c’était : le sérieux de l’art prétendument « sérieux » est, en comparaison du sérieux de la situation dans laquelle nous sommes, c’est-à-dire une situation non seulement d’après catastrophe, mais aussi une situation de catastrophes finales à venir selon toute vraisemblance, ce sérieux, donc, est un sérieux frivole, un sérieux à ne pas prendre au sérieux.
F.J.R. : Donc, vous voulez un monde sans art ?
G.A. : C’est une mauvaise conclusion. Je parle en ce moment de morale et non d’art. Je dis que la notion de sérieux, appliquée à l’art, comparativement au sérieux de notre situation, n’est pas une notion à prendre au sérieux. Je n’ai rien dit sur le fait que l’art est fini ou devrait être fini ; dans le temps qui nous est éventuellement encore imparti, la question art ou non, et même : philosophie ou non, n’est sans doute pas pertinente. Vous voyez : je ne fais pas que jouer avec la pensée de la fin. Comme notre sort repose entre les mains de gens terriblement peu sérieux, je prends le danger terriblement au sérieux.
F.J.R. : Vraiment, vous êtes parfaitement convaincu qu’un fou quelconque déclenchera la bombe ?
G.A. : Oui. Mais pas un fou. Un borné. Quelqu’un qui est trop borné pour se représenter ce qu’il pourrait faire, c’est-à-dire se représenter la puissance de destruction illimitée qu’il détient. Aujourd’hui, celui qui doit passer pour « borné » n’est pas celui dont la pensée, mais dont le pouvoir d’imagination est limité.
Lorsqu’un homme comme Reagan — pour plaisanter, à ce qu’il dit — annonce : « Il y a cinq minutes, j’ai lancé l’ordre d’attaque nucléaire », il est justement tellement peu sérieux et tellement limité que nous nous devons de le prendre terriblement au sérieux.
À cela s’ajoute — et nous en revenons ainsi au début de notre conversation — que ce que vous appelez « folie », ou « déclenchement de la bombe » ne sera entravé par aucun mécanisme d’inhibition ; et cela pour la bonne raison qu’il ne s’agira plus du tout d’un « faire » réel, d’une action, mais d’un simple « déclenchement », qui n’aura aucune idée de l’effet final produit. Le dernier « provocateur » sera probablement un ordinateur assisté par ordinateur. Pour déclencher une folie, il n’est pas besoin de fous au sens médical du terme. Plus une chose peut arriver de manière indirecte plus elle peut arriver facilement, plus il est probable qu’elle arrivera. Pour aussi paradoxal que cela puisse paraître : la médiatisation facilite l’événement. Même l’anéantissement d’Hiroshima, il y a quarante ans, était déjà plus facile et a pu avoir lieu avec « moins d’encombres » que l’assassinat d’un seul individu.
F.J.R. : Ce que vous dites là fait naturellement froid dans le dos et ne donne pas envie d’aller se distraire ensuite. En même temps, je me demande — non, je vous demande : contre quoi voulez-vous encore mettre en garde si vous êtes persuadé que la catastrophe aura lieu ? Ce n’est même plus la peine pour vous de nous mettre en garde.
G.A. : Faux. J’ai parlé à plusieurs reprises — même au début de cet interview je crois — de la nécessité actuelle de la schizophrénie. Je veux dire par là que lorsque nous agissons, nous ne devons absolument pas nous laisser influencer par le désespoir de nos convictions. Mes Thèses sur le siècle de l’atome, dictées aux étudiants de Berlin en 1959 après mon retour d’Hiroshima, se terminaient déjà ainsi : « Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ? » Ce n’est pas un « principe espérance ».
Tout au plus un « principe bravade ».
Et vous n’avez encore rien vu…
13 février 2012

 lavoiedujaguar.net
lavoiedujaguar.net